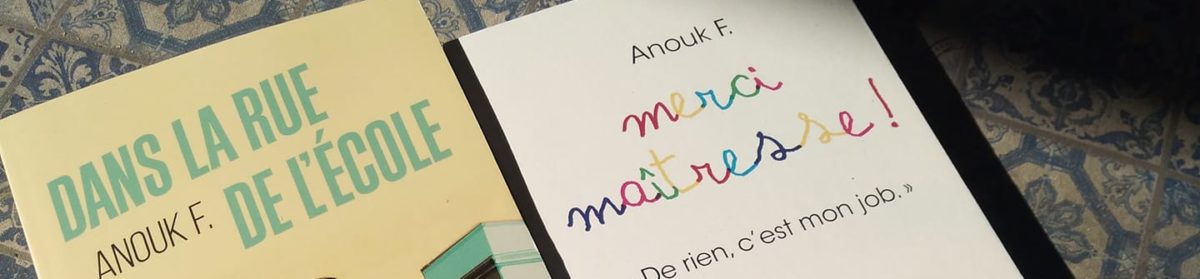Je m’étais levée plutôt de bonne humeur, pourtant. Sur mon vélo, je déroulais d’avance dans ma tête tout ce que j’allais proposer à mes élèves aujourd’hui. Celui-ci qui vient d’arriver du Vénézuela, cet autre qui a quitté le Maroc il y a deux semaines à peine. Je pensais à eux, me félicitant que notre école républicaine leur donne cette chance d’être avec nous, avec tous les autres, et cet immense honneur que j’ai désormais de les accompagner sur le chemin de notre langue.
Une rue après la mienne, les voitures font la queue. La rue est étroite, la voie cyclable en contre-sens. Je slalome, pose plusieurs fois le pied au sol pour éviter les chocs et finis par me retrouver coincée entre un tank rutilant sur ma gauche et une voiture garée sauvagement sur ma droite, sans qu’aucune signalisation ne lui en donne le droit. Debout sur le trottoir, elle entend mon grelot s’énerver, daigne faire une pause dans sa conversation, me regarde pester jusque là plutôt gentiment et me lance quelque chose comme “Je crois que je gêne”. Je tousse et mon visage tout entier confirme son impression. La dame se retourne vers son interlocutrice sur le trottoir et entame un “Ah, j’ai oublié de te dire…”. Ma bonne humeur s’est fait la malle, mes jambes trop courtes peinent à soutenir mes orteils sur la chaussée. Les quelques mots qui sortent alors de ma bouche tentent de rester courtois mais le ton aurait de quoi assécher une forêt tropicale toute entière. “Mais comment voulez-vous que je fasse, Madame, il n’y a aucune place pour se garer ici !”, me rétorque la pipelette, les mains levées vers le ciel.
Une petite voix pleine de sagesse m’a à ce moment là recommandée de me taire. Une autre a pourtant pris le dessus. “Commencez donc par inscrire votre enfant dans son école PUBLIQUE de secteur, vous pourrez l’emmener à pied”. La petite voix sage m’a donnée quelques coups de coude pour m’empêcher de continuer et, mon vélo désormais sous le bras, je suis repartie, ma fureur avec moi.
Sur ce même trajet, quelques jours plus tard, réussissant bon an mal an à cheminer, je croise un homme dont le visage me parle. “Ah me dit-il, nous nous connaissons, nos enfants étaient dans la même crèche”. En baissant les yeux, je vois accrochée à son bras une adorable petite fille que je reconnais sans peine. Nous entamons un brin de conversation et celui-ci m’explique, plein de conviction, qu’il a inscrit sa progéniture dans cette école privée, parce que “bon, il suffit de voir les parents qui viennent chercher leurs enfants, dans l’école de quartier, et t’as compris que ton gosse, il va mal finir, c’est sur. Du coup, ici au moins, on est sûrs que…”. Je ne l’ai pas laissé terminer, l’ai salué et suis repartie.
Ce n’est une surprise pour aucun de ceux qui me lisent et me connaissent. J’ai l’école vissée au cœur et au corps. Et quand elle est publique, elle est carrément chevillée à mes poignets, mes doigts et tout le reste.
Aujourd’hui, je ne supporte plus qu’on la salisse, qu’on s’en détourne, qu’on s’essuie les pieds plein de son refus des autres dessus, qu’on dise d’elle qu’elle déraille, quand c’est le système d’aiguillage qui n’est en fait plus le bon.
Je vomis de savoir que nous avons décidé de ranger les enfants dans des cases et de tout faire pour que ces cases ne se fissurent jamais, que ces individus ne se côtoient pas, et qu’ils n’aient même pas le droit de grandir ensemble.
Je dégueule de comprendre que la société que nous sommes en train de construire sera, à ce rythme, pire que celle d’aujourd’hui. Parce que nos enfants devenus adultes ne sauront même pas comment se regarder tant ils ne se connaîtront pas.
Parce que notre école publique ne sera plus rien que le souvenir d’une belle idée : celle qu’ils sont tous égaux.