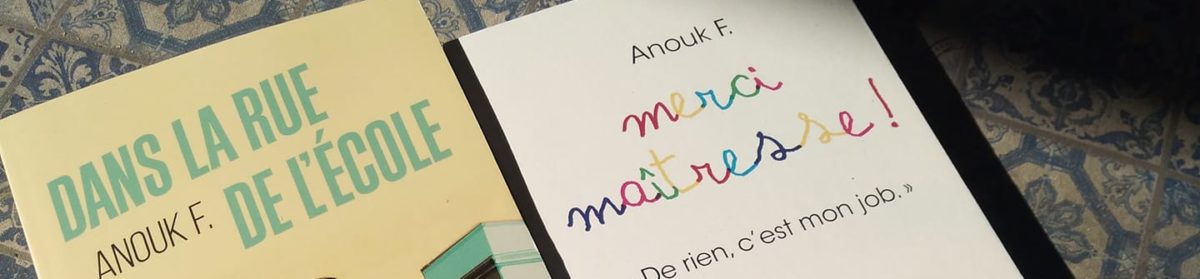Elle cherche ses mots, hésite sur la prononciation puis raconte. Oui, chez elle, en Ukraine, Noël est une grande fête. Est-ce qu’elle peut nous chanter une chanson de Noël ? Oui, tu peux M., bien sûr. Les autres écoutent cette voix qu’ils entendent si rarement, cette langue qu’ils n’ont pas besoin de comprendre pour savoir qu’elle chante la lumière. Ils sont étonnés d’entendre des sons sortir de ce visage. Parce que M. ne parle pas. Ou trop peu. Elle apprend, écrit, réécrit, traduit, se corrige mais ne parle pas. Elle chante, ferme les yeux et les autres sourient.
L’autre jour, Maman m’a dit “Elle veut rentrer”. Elle a laissé un silence. A essuyé ses yeux et a ajouté “Mais on ne peut pas”. Elle a demandé à poursuivre en anglais. Ses mots ont couru, elle parlait vite, comme si respirer entre ses phrases risquait de leur donner trop de réalité. “Ils cherchent le corps de mon frère, je ne sais pas où sont mes cousins, notre maison n’existe plus. On ne peut pas.”.
M. termine sa chanson et rouvre les yeux. Les autres l’applaudissent. Elle sourit, brièvement, puis s’éteint à nouveau.
Dans le hall du collège, ils sont installés derrière leur pupitre. Cinquante, peut-être plus. Des gosses que personne n’aurait imaginé là, un saxophone à la main, un violon sur l’épaule. Des gosses sur lesquels personne ne parie jamais. Je vois A., débarqué sans sa mère du Paraguay deux années plus tôt. Il y a aussi W., réfugiée du Yémen depuis plus de quatre ans aujourd’hui. Ils portent tous un tee-shirt noir et nettoient leurs instruments. Le principal les observe. Des parents ont fait le déplacement. Les professeurs sont là aussi, pas tous, mais nous sommes quelques-uns à venir admirer l’exploit d’avoir fait d’eux des musiciens en quelques mois à peine. M. essaie de se cacher derrière sa chevelure rousse et frisée mais je ne vois qu’elle. J’entends encore sa voix si douce et déterminée chanter.
Silence.
La chef d’orchestre, debout sur un tabouret balance ses bras et les sons sortent. Personne ne chante cette fois, mais les paroles sont sur toutes les lèvres.
Allons enfants.
De la patrie.